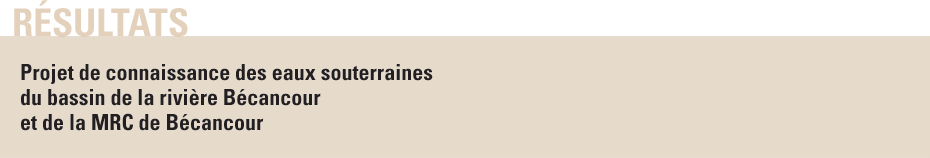Propriétés hydrauliques
L’eau souterraine remplit les porosités du milieu géologique, c’est-à-dire les fractures et les espaces entre les grains, que ce soit dans les dépôts meubles ou dans le roc. Plus la porosité du milieu géologique est élevée, plus il y a d’espace disponible pour emmagasiner de l’eau dans ce qui constitue l’aquifère. Pour qu’une unité géologique soit intéressante pour l’approvisionnement en eau souterraine, il faut aussi que cette eau se renouvelle, c’est-à-dire qu’il faut que les vides communiquent entre eux pour que l’eau puisse circuler d’un endroit à un autre. Pour évaluer si le contenant qu’est le milieu géologique constitue un bon aquifère, il faut connaître sa porosité et son degré de fracturation. Pour définir la capacité d'une formation géologique à transmettre l’eau rapidement d’un vide à l’autre, il faut mesurer sa conductivité hydraulique. Plus cette dernière est élevée et plus l’aquifère est productif.
Interprétation pour la zone d'étude
Les différentes données d’essai hydraulique disponibles lors de ce projet (essais sur le terrain, données de consultants, traitement des données du système d’information hydrogéologique du Québec) ont montré qu'il n'existait pas de différence notable de conductivités hydrauliques entre les différents Groupes géologiques du roc. Les résultats indiquent cependant une légère différence entre la zone amont (Schiste de Bennett et Groupe de Sillery) et la partie aval. L’hétérogénéité est également plus importante dans la zone amont, ce qui pourrait refléter une plus grande fracturation. À l’inverse, les essais réalisés sur les formations géologiques de la partie aval, notamment les groupes de Lorraine et de Queenston, ont montré plus d’homogénéité, et sont représentés par une valeur moyenne de conductivité hydraulique plus faible. Les conductivités hydrauliques mesurées dans les dépôts granulaires ont été généralement plus élevées que pour celles du roc fracturé.