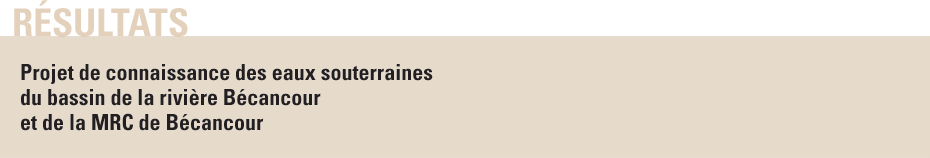Contextes hydrogéologiques
Les contextes hydrogéologiques représentent la répartition spatiale des séquences hydrostratigraphiques typiques des dépôts meubles. La carte des dépôts quaternaires montre la répartition spatiale des dépôts présents en surface, mais ne permet pas de visualiser comment sont organisés les sédiments avec la profondeur. L’agencement stratigraphique avec la profondeur est connu à partir des forages. La compilation, l’analyse et le traitement de ces informations géologiques permet de produire un modèle en trois dimensions des unités quaternaires. La représentation des contextes hydrogéologiques est toutefois faite sur une carte en deux dimensions, en regroupant les successions d’unités quaternaires typiquement rencontrées. Par exemple, une première unité typique pourrait être une zone définie par une couche d’argile en surface, reposant sur une unité de sable en contact avec le roc. Une deuxième unité serait définie par une mince couche de sable présente en surface, reposant sur une unité de till en contact avec le roc, etc.
Figure 8 Contextes hydrogéologiques

Interprétation pour la zone à l'étude
La Figure 8 illustre la répartition spatiale des contextes types. La partie amont est dominée par les contextes de till, de till remanié et de matériel granulaire reposant sur le till. Dans cette partie de la zone d’étude, l’épaisseur de l’unité de till demeure généralement inférieure à 3 m et celle de l’unité granulaire demeure inférieure à 10 m. Cependant, dans le secteur de Lysander Falls, à la jonction de la rivière Bécancour et de la rivière Palmer, des épaisseurs de matériel granulaire de 20 m ont été observées dans certains forages.
Dans la partie centrale, la stratigraphie est dominée par une séquence de dépôts granulaires reposant sur un till généralement compact qui peut atteindre plusieurs mètres d’épaisseur. Les dépôts granulaires sont quant à eux d’épaisseur très variable allant de 1 m à plus de 10 m dans le secteur amont de la Petite rivière du Chêne. Ces dépôts granulaires ne constituent pas un aquifère majeur bien que certaines petites municipalités (Villeroy, Sainte-Eulalie et Saint-Rosaire) puisent leur eau dans cette unité. Dans la partie sud-ouest de la zone centrale se retrouve du till remanié reposant sur le roc fracturé.
Une transition vers les contextes argileux et une complexification importante de l’hydrostratigraphie est observée vers l'aval de la zone d'étude. Ceci est principalement dû à la présence des unités de quaternaire ancien souvent présentes sous les dépôts argileux ou sous le till. Dans cette portion de la zone d’étude, les dépôts argileux peuvent atteindre des épaisseurs de plusieurs mètres à plus de 20 m. L’unité « dépôts quaternaire » comporte deux unités perméables (sables des Vieilles Forges et de Saint-Pierre) séparées par une unité imperméable (varves de Deschaillons). Les unités les plus importantes en termes d’épaisseur sont les sables des Vieilles Forges et les varves de Deschaillons. Dans le secteur central du bassin versant de la rivière Gentilly et de la tourbière du lac Rose, ces unités peuvent atteindre plus de 20 m d’épaisseur. Les sables des Vieilles Forges constituent l’aquifère granulaire le plus important de la zone d’étude en raison de leur épaisseur. Cette unité alimente en eau potable une partie de la municipalité de Bécancour ainsi qu'une usine d’embouteillage commerciale. Les dépôts quaternaires anciens disparaissent complètement dans la partie sud-ouest de la portion aval de la zone d'étude, à l’ouest de la rivière Bécancour, où ils sont remplacés par une couverture d’argile reposant sur le till. L'étendue spatiale de cet aquifère est présumée importante, mais n'a pas pu être délimitée précisément dans ce projet.