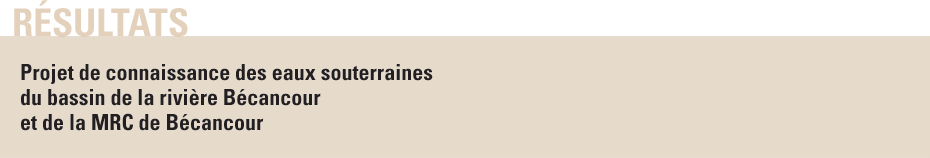Bilan hydrique régional
Le bilan hydrique est une évaluation des quantités d’eau qui contribuent aux différents flux du cycle de l’eau :
- Les précipitations, sous forme de pluie ou de neige, sont la source d’apport en eau dans le système. Elles dépendent principalement des conditions climatiques.
- L’évapotranspiration correspond à l’eau qui est transpirée par les plantes et évaporée au niveau du sol. Elle dépend du type de végétation, des propriétés physiques du sol, de la température, du taux d’humidité dans l’air et de l’insolation solaire.
- Le ruissellement de surface survient lors d’un évènement de précipitation durant lequel la capacité d’infiltration du sol est atteinte de sorte que l’eau ne peut plus y pénétrer et s’écoule en surface. Il dépend, entre autres, du climat, de la pente, du type, des propriétés physiques et de l’utilisation du sol.
- L’écoulement hypodermique s’effectue près de la surface et est constitué de l’eau qui s’infiltre dans le sol et qui circule horizontalement dans les couches supérieures jusqu’à ce qu’elle fasse résurgence à la surface, par la pente du terrain.
- La recharge correspond à l’eau qui s’infiltre dans le sol et qui atteint l’aquifère.
Pour assurer la pérennité de l’eau souterraine dans une région, il est utile de connaître les quantités disponibles ainsi que le taux de renouvellement de l’eau souterraine qui correspond à la recharge.
Interprétation pour la zone d'étude
Figure 11 Évolution temporelle des flux moyens du bilan hydrique (1990-2010)

Les résultats généraux du bilan hydrique sont montrés à la Figure 11. Pour la période simulée, les apports verticaux sont en moyenne de 1050 mm/an. Le modèle simule un ruissellement total (de surface et d’écoulement hypodermique) de 600 mm/an pour l'ensemble de la zone d'étude et pour la période 1990-2010, soit l'équivalent de 57% des apports verticaux. L'évapotranspiration moyenne annuelle simulée par le bilan hydrique est de 291 mm/an (28% des apports verticaux). La recharge moyenne de l’aquifère fracturé pour l'ensemble de la zone d'étude est de 159 mm/an, soit 15.1% des apports verticaux. Le débit total pompé à l’aquifère par les grands préleveurs et les particuliers correspond à une hauteur d’eau de 2 mm/an. Ce flux est très faible en comparaison aux autres écoulements quantifiés dans la zone d’étude. Le volume d’eau qui retourne au fleuve Saint-Laurent est estimé à 7 mm/an au moyen de la modélisation des écoulements souterrains. Ce flux très faible s’explique par la géométrie de l’aquifère dans la partie aval de la zone d’étude où des écoulements souterrains très lents ont été mis en évidence par la géochimie. Il est probable que l’aquifère soit alimenté de l’amont (des Appalaches) par un flux d’eau souterraine de l’ordre de 9 mm/an.
La réalisation du modèle de l’écoulement souterrain a également permis de démontrer que les tourbières contribueraient à près de 1.7 m3/s d’eau à l’aquifère. Il existe donc des échanges de volumes d’eau entre les aquifères et les tourbières. Il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux complémentaire afin de rafiner l’analyse et d’évaluer l’impact des changements climatiques et des débits pompés. En effet, les activités humaines ont contribué de façon importante à la perte et la dégradation des milieux humides. Les résultats obtenus par Avard, Larocque et Pellerin (2013) démontrent que 24 % des superficies occupées par les tourbières en 1966 ont aujourd’hui disparu, tandis que 30 % ont subi des perturbations limitées. Les canaux de drainage et les chemins forestiers sont les principales perturbations limitées observées dans la zone d’étude. La culture de canneberges est la principale cause de la disparition des tourbières dans cette région entre 1966 et 2010.
Télécharger l'étude d'Avard, Larocque et Pellerin (2013)
Figure 12 Bilan hydrique de la zone d'étude

La variabilité temporelle des flux moyens résultant du calcul du bilan hydrique sur la zone d'étude de 1990 à 2010 montre que l’aquifère agit comme un réservoir qui atténue les fluctuations annuelles des apports verticaux (Figure 12). En effet, si le ruissellement de surface et hypodermique varie de manière assez marquée suivant les apports verticaux, la recharge est relativement peu affectée par ceux-ci. Ceci reflète le fait que la quantité d’eau souterraine disponible est moins sensible aux variations interannuelles des précipitations que les débits de crue qui sont majoritairement composés de ruissellement de surface et hypodermique.